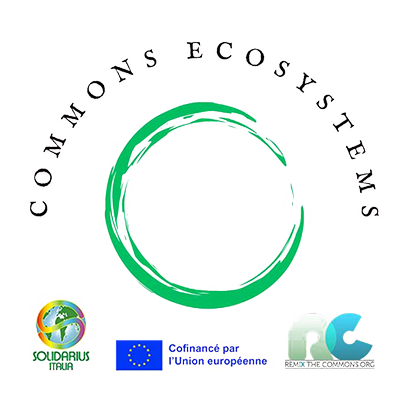Se mobiliser pour tous bien manger à La Chapelle
Article Par: Camille Laurent et Frédéric Sultan (2025 06 14)
🔗 Contexte : Classe > Faire Écosystème > Bien manger à La Chapelle
 |
 |
 |
|---|
Du 28 janvier au 1er février 2025, avec les habitants du quartier de la Chapelle à Paris, la co-création d’un jeu Cartes en commun a été l’occasion de mobiliser les acteurs de l’Alimentation en commun du quartier. La démarche leur a permis de se connaître, de rendre visibles les défis auxquels ils s’affrontent et d’ébaucher des pistes d’actions et de stratégies communes qu’ils ont commencé à mettre en place depuis. Initiée par Remix the commons (ou Remix) dans le cadre de projet ERASMUS+ Ecosystème des communs en partenariat avec Solidarius Italia, la démarche met en avant le riche écosystème des communs dans le domaine de l’alimentation. La co-création d’un jeu de cartes sur l’Alimentation en commun a été un formidable levier de mobilisation, d’interconnexion et de renforcement de la puissance des habitants à La Chapelle.
Au cours des dernières années, la notion de communs a été placée sur le devant de la scène pour devenir le marqueur d’une volonté de changer la société en poussant pour davantage de solidarité, de démocratie et d’engagement citoyen dans les affaires publiques et pour la sortie de la spirale de l’accaparement des ressources communes.
Remix est un collectif de production au service du mouvement des communs, c’est à dire qu’il accompagne ce renouvellement politique et culturel en contribuant à l’arrivée à maturité de l’ingénierie et de la culture de l’agir en commun au service des commoners. Son rôle consiste à faire connaître ces initiatives et accompagner leur transformation en propositions politiques, qu’elles soient concrètes ou bien l’objet d’un plaidoyer qui pourra être porté par les personnes concernées dans la sphère publique. Dans les deux cas, cela va contribuer à un agenda politique, celui de la transition sociale et écologique et des communs.
 |
 |
 |
|---|
Dans le cadre de cette mission, un premier défi consiste à rendre intelligible les communs, ce qu’ils sont, ce qu’ils nous font et comment ils nous aident à penser et faire advenir des futurs désirables. Dépasser un positionnement et un discours théorique est un deuxième défi à relever. Pour cela, nous proposons d’approcher les communs à partir d’un ensemble de thématiques qui elles sont bien pratiques et intelligibles par les personnes concernées.
A La Chapelle, le Commons lab s’intéresse à l’alimentation. Dans d’autres projets, ce sera l’accès à l’eau, la gestion rurale, ou encore par exemple la production de médicaments en commun. Autour de chacune de ces thématiques, s’expérimentent des processus d’exploration, de découverte et d’apprentissage de ce qui dans les communs, nous lie, nous tient et nous transforme. C’est ainsi qu’est née l’école des communs qui pourrait se nommer « zone d’éducation populaire ». Il s’agit de créer des outils d’identification et/ou de mises en œuvre de dynamiques solidaires collectives attachés à différents sujets, à l’échelle d’un territoire et avec une communauté.
A La Chapelle, une première expérience d‘école des communs a été initiée en 2020. Financé par la Fondation Paris Habitat, l’école des communs de la Chapelle avait la gouvernance des collectifs militants pour objet d’étude. A travers 5 ateliers ont été explorés l’importance de l’accueil, de l’argent et des ressources, de l’espace, du temps et de la communication dans la gouvernance des collectifs militants dans le quartier La Chapelle.
Le commons lab sur l’alimentation est une nouvelle expérience d’école des communs à La Chapelle, cette fois inscrite dans un projet ERASMUS +, de formation pour adultes, porté en France par Remix et en Italie par Solidarius. En plus du commons lab à La Chapelle sur l’Alimentation, 3 autres se sont déroulés à Toulouse, sur le thème « Habiter Toulouse», à Naples sur l’économie des communs, et à Mondeggi à côté de Florence sur la co-gouvernance d’une ferme coopérative. Chacun des commons lab a utilisé des méthodes différentes pour construire son processus d’identification et de mise en œuvre de solution basées sur les communs et le commoning.
L’alimentation à la Chapelle.
La Chapelle est un quartier populaire au nord de Paris qui dispose d'une histoire et d’une expérience sociale exceptionnelle en matière d'engagement citoyen et militant en raison notamment de son relatif isolement et des difficultés qui s’y retrouvent depuis qu’il s’urbanise et intègre la capitale. Il est le creuset d'un ensemble d'initiatives qui participent de la réappropriation sociale de l'alimentation et qui impliquent les différentes classes sociales et communautés culturelles du quartier. Elles forment un véritable éco-système fait de liens noués avec d'autres acteurs du quartier : cantines scolaires, restauration rapide, espaces de solidarité ou bien en dehors du périmètre du quartier comme les réseaux de jardins issus de l'agriculture urbaine, les circuits de récupération.
L'alimentation tient une place singulière dans l'imaginaire des habitants du quartier même si elle fait rarement l’objet d’une mise en valeur particulière dans les récits sur le quartier. Certains acteurs ne se croisent pas ou rarement comme ceux qui fréquentent les circuits d'approvisionnement propres à des communautés culturelles qui se sont installées ici au cours des siècles et les habitants de la classe moyenne. De plus, les moyens de coordination de cet entremêlement d'initiatives citoyennes aux orientations écologiques, sociales et culturelles parfois différentes, sont modestes.
Néanmoins, c’est dans ce terreau qu’émerge par exemple Ecobox ou Vergers Urbains, parmi les premières initiatives d’agriculture urbaines à Paris ou La Louve premier supermaché coopératif de France.
Cette constellation d’initiatives autour de l’alimentation est imergée dans la foisonnate société civile de ce quartier. Pour considérer un écosystème de l’alimentation, il nous faut commencer par nommer la question qui les réunis. Bien manger, que chacun et chacune mange bien est une préoccupation partagée par les personnes engagés dans toutes ces initiatives et plus largement par les habitants du quartier. Chacune des initiatives prend en charge une partie de cette préoccupation.
Dans ce contexte, le Commons Lab a proposé une stratégie d’action pour révéler la richesse et la diversité des initiatives solidaires individuelles et collectives et offrir un espace de conversation à celles et ceux qui souhaitent s’organiser pour rendre plus puissantes leurs actions dans le quartier de la Chapelle. Rapidement il se confirme que dans de nombreux cas, les liens existent mais sont incarné dans des personnes et ne sont pas compris comme une richesse, un maillage qui fait tenir ensemble la communauté. L’objectif du Laboratoire et de la production du jeu a donc été de participer à l'identification des acteurs et des jeux entre les acteurs pour gagner en puissance d'agir.
 |
 |
 |
|---|
Le commons lab procède par la construction d’un programme de rencontres, visites et de micro-activités qui vont être l’occasion de récolter le contenu des cartes d’un jeu Cartes en commun, en train de se créer. Il se porte au devant des personnes et des collectifs pour les rencontrer, discuter de leur force ou leur faiblesse pour faire face à leurs difficultés du moment. Le résultat de ces recontres est sytématiquement reccueillit sous la forme de nouvelles cartes conçues et dessinées par les participants qui composeront un nouveau jeu.
Cartes en commun prend le quartier comme plateau de jeu. Les cartes représentent les initiatives qui s’y déploient. Ce sont les ressources que les joueurs pourront activer pour ensemble se mobiliser contre les cartes qui représentent ce qui leur fait obstacle ou les empèche. L’art d’accueillir et de récolter cette conversation se déploie à travers une programmation fine du Commons lab dans le quartier. Selon les lieux, les personnes et les besoins, différentes méthodologies sont utilisées, des entretiens individuels, des activités en groupe, des visites guidées, la simple observation, … Mais le programme du commons lab ne laisse rien au hasard. Comme le montre le shéma de facilitation ci-dessous, chaque rencontre est préparée pour cibler une catégorie de questions précise afin d’assurer une bonne récolte et la réalisation d’un jeu fonctionnel dans n’imorte quel contexte.
La fabrication des cartes représente une part essentielle du travail du Commons Lab. Au cours de chaque rencontre ou visite, les participants sont invités à créer leurs propres cartes en utilisant un canva au format A4. Il faut définir le nom de la carte, l’objet, le personnage, l’initiative, la force le caractère ou encore ce à quoi on s’affronte et dessiner une illustration de ce sujet. Cette carte sera ensuite scannée et mise à la taille d’une carte à jouer et imprimée pour être collée sur une carte vierge, ce qui représente un travail manuel impotant mis à profit pour discuter autour des enjeux de l’alimentation et de la démarche pédagogique en train de se vivre. Pour constituer chaque jeu, il suffira alors de sélectionner le nombre de cartes prédéfini pour chaque catégorie qui permet un équilibre des forces jouable.
Le jeu de cartes réalisé reflète les mécanismes de l’engagement dans le commoning pour l’alimentation en commun dans ce quartier. Les cartes évoquent des histoires, des personnages et des situations connues des habitants de La Chapelle. On ne sera pas surpris de retrouver les initiatives des habitants. On le sera plus d’y découvrir les obstacles rencontrés ou encore les sentiments de frustration et parfois de colère qui motivent la mobilisation dans ce quartier populaire du nord de Paris. Enfin, les mécanismes du jeu ne sont pas propres à ce quartier et le jeu peut être utilisé par des personnes qui ne connaissent pas le quartier, juste pour jouer.
Adapter le jeu à la Chapelle
Le jeu est collaboratif, les joueurs doivent s’organiser pour lutter contre des menaces qui peuvent être urgente ou de long terme. Pour cela ils et elles disposent de ressources de plusieurs ordres : des acteurs clés et des alliés (dans tous les domaines, par exemple un bon comptable est un allié dans la mise en œuvre d’une initiative associative), des richesses, et moyens (matériels comme une salle de réunion, ou financier comme le budget participatif), des motivations, valeurs et désirs qui sont à l’origine de nos actions et , et des savoirs faire ou compétences. Les joueurs doivent réunir ces ressources pour organiser des initiatives qu’ils lanceront ensuite en campagne contre les menaces ou accaparements, en additionnant les forces de ces projets des plus petits aux plus ambitieux. Ils pourront ainsi contrer les logiques néolibérales et capitalistes qui nous empêche de faire commun.
 |
 |
 |
|---|
Le jeu original a été conçu par Matthieu Rhéaume dans le cadre du Forum social Mondial de Montréal en 2016. Cette première version réunissait des cartes sur les thématiques variées présentes lors du forum : des semences traditionnelles, au logiciel libre, en passant par les résistance à l’accaparement de l’eau, des forêts, des terres ou la chasse à la baleine. Les catégories et les questions ont été adaptées pour le contexte de la Chapelle afin de rendre visibles et de questionner les interdépendances dans le quartier.
Avec l’alimentation des questions à ne pas oublier de se poser
Le Commons Lab de la Chapelle s’est déroulé du 28 janvier au 2 février 2025. Le jeu de carte a été produit tout au long de la semaine et a été joué le dernier jour.
En allant au devant des initiatives de la communauté, le risque est important d’avoir des angles morts, voir des effets contre-productifs de survalorisation de certaines pratiques solidaires au détriments d’autres plus éloignées pour diverses raisons des participants et des collectifs engagés dans le Commons lab. Une attention particulière a été portée sur la capacité des participants au Commons lab à rejoindre une diversité d’acteurs pour avoir des points de vue multiples et à éviter que cette démarche ne contribue malgré elle à des formes d’éco-embourgeoisement du quartier en mettant l’accent sur les initiatives qui disposent déjà de plus de visibilité et de reconnaissance dans l’espace public. Afin d’éviter cet écueil, nous avons élaboré une grille d’analyse pour porter le regard sur certaines caractéristiques des initiatives collectives au regard de la souveraineté alimentaire.
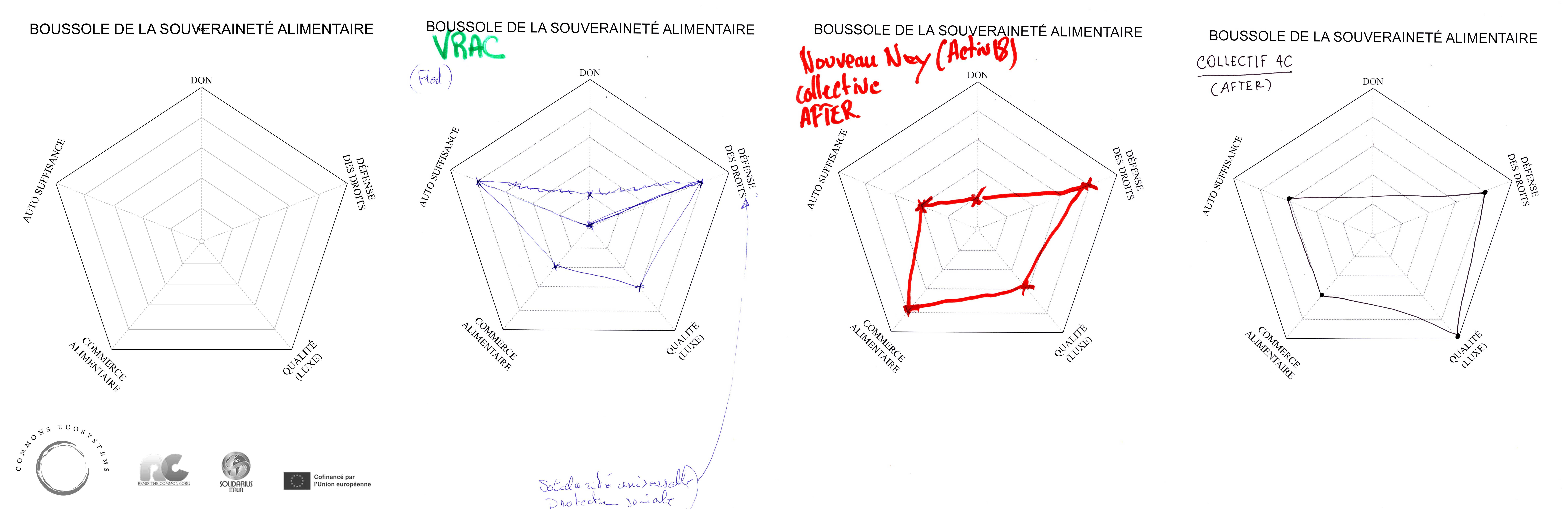
Cette Boussole de la souveraineté alimentaire, utilisée avant et après certaines des rencontres et des ateliers a permis révéler quelques stéréotypes des participants et d’ouvrir un riche débat sur les enjeux de la souveraineté alimentaire dans ce quartier et de leur prise en compte dans le contexte du commons lab, de l’école des communs et par le mouvement des communs en général. Résultat, plus qu’un jeu, une dynamique mobilisatrice Le résultat est bien sur un jeu, produit en 4 exemplaires, 3 en français et 1 en anglais qui peut être joué au-delà du quartier. Mais les apprentissages dépassent la production du jeu :
• S’identifier, se connaître, créer des liens
• Partager des informations : L’expérimentation de la Sécurité Sociale de l’Alimentation avec la Mairie et ACF
• Visibiliser des problématiques spécifiques au quartier auxquelles les collectifs et les habitants sont confrontés : Le manque de lieux d’achat et de marché dans la zone Hebert / porte de la Chapelle
• Questionner et dépasser la dualité gentrification / Quartier populaire … pour y revenir plus tard (la toile d’araignée)
• Identifier les initiatives qu’on aurait envie de voir se développer et parmi celle-ci, celles où chacun souhaite s’investir
• Renforcer l’idée d’écosystème des communs
Le jeu est donc un commun (outil parmi d’autres de l’écosystème des communs école des comuns) et le processus de co-création dépasse le jeu pour être un processus de mobilisation politique (ou de commoning) propre au quartier de la Chapelle. Cela est confirmé par la suite dans le quartier puisque depuis janvier 2025, certaines des initiatives identifiées à l’ocasion du commons lab voient le jour et sont prises en charge par les participants et les collectifs qui ne se connaissaient pas avant le commons lab. C’est le cas de la mobilisation contre le désert alimentaire de la Porrte de La Chapelle ou encore, les banquets dans le quartier ou encore la SSA (Sécurité sociale de l’alimentation). L’écosystème des communs redouble de dynamisme et la place de l’alimentation dans le débat public local gagne en importance et sort du seul giron des autorités publiques.